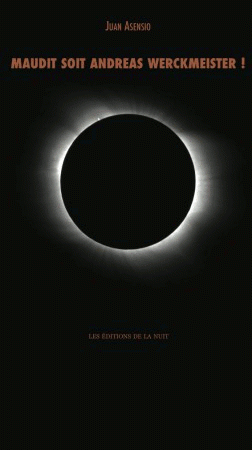Dans la deuxième partie de notre texte consacré à L’Enchâssement de Ian Watson, nous avions surtout évoqué les expériences sur des enfants aphasiques menées au Centre Haddon. Mais parallèlement aux recherches du linguiste Chris Sole, son vieil ami français Pierre Darriand (qui n’est autre que le père de son enfant…), anthropologiste, vit parmi les Xemahoa, peuple amazonien menacé par un titanesque projet de barrage, mené par le Brésil et les Etats-Unis d’Amérique, qui doit à terme noyer la majeure partie de l’Amazonie sous les eaux. Avant d’aborder dans notre quatrième et dernière partie la trame la plus intéressante de ce récit de science-fiction (je veux bien entendu parler des extraterrestres Changeurs de Signes), attardons-nous quelques instants sur cette étrange tribu.
Dans une lettre adressée à Sole, Pierre évoque donc les Xemahoa, cette tribu exceptionnelle qui non seulement obéit à des lois différentes (par exemple l’inceste y est vivement encouragé, et leur système numéral est avant tout relatif), mais qui, surtout, possède deux langages : une langue quotidienne, traditionnelle, et une autre beaucoup plus complexe (le xemahoa B), un langage « enchâssé » compréhensible seulement pendant des transes provoquées par une drogue, le maka-i, ingéré lors d’un rituel initié par le bruxo (le chaman xemahoa). Comme Sole avec le langage artificiel développé par les enfants du Centre Haddon, Pierre Darriand compare le xemahoa B aux Nouvelles Impressions d’Afrique... Lisons un extrait de ses notes sur la langue xemahoa : « Si le xemahoa B – le langage drogué – est aussi profondément enchâssé que me le laissent penser mes enregistrements, alors l’expression, l’affirmation du “maintenant” est déjà grosse de l’achèvement à venir de cette affirmation. Cela vise à abolir l’étalement dans le temps d’un énoncé, étalement inévitable du fait même de la durée matérielle de l’énoncé, et durée au cours de laquelle l’objet de l’énoncé pourra avoir changé, ce qui, du coup, l’invalidera. » (pp. 81-82) Et plus loin : « Les prédicats “yi” et “yi-yi” y jouent un rôle important. Ainsi, le mot composé “kai-kai-yi” signifie “x” quanta de l’objet temporel mesuré (les phases de la grossesse, de l’histoire de l’Homme ou d’une cérémonie) en aval du cours du temps. Alors que, tout aussi utile et ingénieux, le terme “yi-kai-kai” signifie “x” quanta en amont du présent vers le passé, remontant le cours de ces enchâssements de mots qui, comme un fleuve, charrie la vie. » (p. 82)
Autrement dit, les Xemahoa « dansent le temps au son des mélopées du bruxo ». L’absence de référence précise au temps dans la langue xemahoa renvoie à l’étude des indiens Hopi par Whorf, pour qui cette particularité réfutait l’idée d’universalité linguistique – cela est toutefois sujet à caution : certains ont montré qu’en vérité, les Hopi avaient bel et bien des expressions pour exprimer les notions temporelles… Mais il semblerait que nos Xemahoa soient plus whorfiens que les Hopi ! Pour Whorf, c’est notre langue d’origine qui nous permet d’organiser le « flux kaléidoscopique d’impressions » sous lequel se présente le monde. Darriand poursuit : « Ce discours enchâssé n’est autre que la châsse où sont serrés l’âme, les mythes, de la tribu. Mais cela permet également aux Xemahoa de faire l’expérience immédiate de leur vie mythique au cours de ces célébrations à la fois chantées et dansées. Le dialecte vernaculaire quotidien, le xemahoa A, est passé au crible d’un re-codage extrêmement élaboré qui brise les séquences linéaires du parler normal et restitue le peuple xemahoa à cette unité spatio-temporelle de laquelle, nous autres, avons été coupés. Car nos langages se comportent comme des barrages entre la Réalité et notre Idée de la Réalité.
« Je suis enclin à penser que le xemahoa B est le langage le plus vrai que j’aie jamais rencontré. Il est évident qu’à d’autres égards – pour tout ce qui concerne la vie quotidienne – il met à mal, paralyse, infirme notre vision strictement euclidienne du monde. C’est un langage extravagant, semblable en cela à celui de Roussel, mais pire. L’esprit ne peut espérer seul, sans adjuvant, l’appréhender. Mais dans leurs hallucinations, ces Indiens ont découvert l’élixir vital de la compréhension. » (p. 117)
Ainsi, pour Darriand, nos langages non seulement ne restitueraient de la réalité qu’une vision toute relative, mais encore cette vision serait fausse, et le langage, totalitaire – en opposition à une vraie réalité, à laquelle notre langage ne nous donnerait pas accès... Voilà qui nous renvoie encore à Korzybski, qui rappelait que contrairement au langage mathématique – un langage conforme à ce qu’il décrit –, les langages employés par les bâtisseurs des structures sociales, économiques, politiques, ne sont pas strictement similaires à la structure de la réalité, des faits, des événements (d’où leurs échecs récurrents). Pour s’adapter à son environnement sans courir au désastre (des guerres mondiales par exemple), l’homme, toujours selon Korzybski, doit donc modifier sa conception du monde, rompre avec la logique aristotélicienne et inaugurer la Sémantique Générale, où la raison mathématique prévaut. Aussi « extravagant », aussi roussellien, aussi fou soit-il, le Xemahoa B repose sur le principe a priori très rationnel de l’enchâssement, et permettrait donc aux membres de la tribu, selon Darriand, d’atteindre à la compréhension du monde. Les Xemahoa auraient très exactement trouvé la solution aux recherches menées à titre expérimental au Centre Haddon. D’aucuns ont reproché à l’épisode des indiens Xemahoa de faire double emploi avec les passages consacrés au Centre, puisqu’il ne s’agit jamais, selon eux, que de nous présenter un langage enchâssé censé révéler sinon une autre réalité, du moins la réalité sous un autre jour... Si l'on s'en tient à ce que nous venons d'écrire, c'est juste. Mais le rapprochement des deux intrigues me paraît justifié, pour plusieurs raisons. Premièrement, l’étude des Xemahoa par Pierre Darriand propose un nouvel angle d’attaque, une autre façon d’appréhender une même réalité – préoccupation qu’on trouve précisément au cœur du roman. Ainsi, aux artifices du Centre répond l’harmonie des Xemahoa avec la nature ; au scientisme de Sole et de ses collègues répond le mysticisme des indiens. Cette opposition nous permet du reste de mettre en lumière une différence fondamentale : la mathématique pure permet certes à Chris Sole d’approcher certaine vérité, mais elle se heurte inévitablement au problème des « totalités illégitimes », pour utiliser la terminologie de Bertrand Russell : délimiter les « frontières de la pensée », c’est remplacer les schémas ainsi délimités par un nouveau schéma, qui dès lors devrait être lui-même inclus dans un ensemble plus vaste (dans les ultimes lignes du roman, Ian Watson parlera même d’un « camp de concentration »…) ; tandis que les Xemahoa s’accordent symbiotiquement par l’enchâssement à leur environnement naturel et à leurs mythes, bref, à leur monde dans sa totalité (nous allons y revenir dans un instant), sans accusation d’illégitimité. Et deuxièmement, l’entrelacement des deux intrigues permet à Watson de construire son roman de manière enchâssée – mais un enchâssement simple, fort compréhensible, somme toute très commun – : l’idée centrale s’en trouve évidemment renforcée.
À en croire Pierre Darriand, les Xemahoa auraient donc réussi, sous certaines conditions, ce que Chris Sole projetait avec les enfants de l’univers enchâssé du Centre : repousser les limites de la compréhension – et de l’esprit. Mais selon l’anthropologiste, les Xemahoa vont plus loin encore, et, sous l’influence de leur langage enchâssé, prétendent soumettre la réalité à leurs perceptions ! En prisant le maka-i en effet, le bruxo « […] ne vise rien moins qu’une perception totale de la Réalité qu’il restitue immédiatement dans le présent éternel de l’hallucination. Et, par cette reconstitution globale de la réalité, il pense pouvoir se donner les moyens de la contrôler, de l’infléchir. Le vieux rêve du sorcier !
[…] « Pour le bruxo comme pour les Xemahoa, la connaissance n’est pas une chose abstraite, mais plutôt codée en termes d’oiseaux et de bêtes, de roches et de plantes, en termes de forêt, avec les nuages et les étoiles qui la surplombent, dans les termes mêmes de la réalité donnée, concrète. C’est pourquoi la description globale de cette connaissance n’est pas une opération abstraite, mais une mainmise sur la réalité factuelle qui les entoure. Cette appréhension de la réalité revient à la contrôler, par là, à la manipuler. C’est, du moins, ce qu’il espère.
« Il doit bientôt entreprendre une gigantesque narration enchâssée de tous les mythes de la tribu ainsi codés en cet instant précis de leur histoire, de leur conscience. Jour après jour, au cours de la danse droguée, il accumule les éléments de la signification totale que doit prendre en charge sa narration, c’est-à-dire qu’il garde présent à l’esprit tout ce qui a été énoncé les jours précédents, qu’il le garde dans le présent éternel de son esprit inspiré par la drogue, malgré la tension terrible qu’en subissent son corps et son cerveau.
« Il doit bientôt parvenir à exprimer la conscience totale de l’Être. Bientôt, il percevra dans sa clarté le schéma qui sous-tend la pensée symbolique du mythe. » (pp. 118-119)
Et cet événement pur coïncidera avec l’accouchement d’une femme, mise à l’écart de la tribu et bourrée de maka-i au mépris des menaces de malformation. Les Xemahoa ne parlent-ils pas de « l’enfant enchâssé (c’est leur mot) dans le ventre de la femme enfermée dans la hutte » (p. 73) ? La dimension christique de cette prophétie (dont Pierre, comme le saint dont il porte le nom, serait le premier apôtre ?...) n’aura échappé à personne. Cette communion des Xemahoa avec leur monde, grâce au maka-i et au langage enchâssé, cette « conscience totale de l’Être », n’est-elle pas une forme animiste d’eucharistie, d’expérience sensorielle de l’union hypostatique catholique ? Mais ces troublantes ressemblances avec certains éléments de doctrine ne sont pas fortuites : à plusieurs reprises nous croisons le chemin de prêtres missionnaires, qui ont tenté (sans succès, selon eux) de porter la parole du Christ auprès d’indigènes qui paraissent, par leurs transes, avoir à leur tour enchâssé ces mythes chrétiens dans leur propre représentation du monde.
Lorsqu’il nous décrit les étranges particularités des Xemahoa, Pierre Darriand nage-t-il en plein délire, ou est-il dans le vrai ?... Difficile de répondre. Le dénouement de l’affaire du barrage amazonien (les Xemahoa ont essayé, par une narration enchâssée, de tordre le réel à leur guise, or le barrage est effectivement détruit, pour des raisons que nous évoquerons dans notre dernière partie…) brouille les pistes. Le bruxo a-t-il eu la vision du soudain reflux des eaux, au cours de sa narration enchâssée ? Ou ne s’agit-il que d’une coïncidence ?...
Vous le saurez (ou pas) en lisant la dernière partie de notre article : Les Changeurs de Signes…
2- Les expériences de Chris Sole
À suivre…